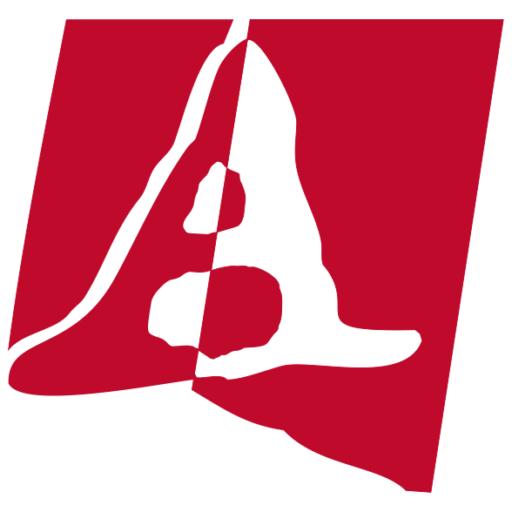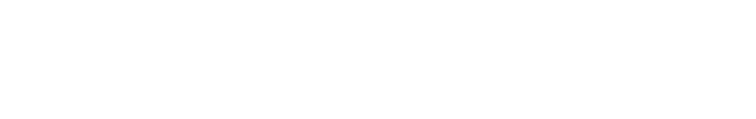Le Népal, pays très montagneux, a beaucoup recours à l’hydroélectricité pour sa consommation domestique. Toutefois, malgré des avancées concrètes en matières de droits humains par les entreprises, le pays peine encore à respecter certains droits des travailleurs et des travailleuses, tout en développant sa filière hydroélectrique en respect de l’environnement.
L’un de mes mandats lors de mon stage au Nepal Development Initiative (NEDI), une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion des entreprises vertes et à la lutte contre les défis environnementaux à Katmandou et à travers le pays1, consistait à réaliser une recherche qualitative sur l’état actuel des entreprises et des droits humains (BHR) au Népal, en mettant particulièrement l’accent sur le secteur en pleine expansion de l’hydroélectricité.
Si ce type de production d’électricité offre des opportunités considérables en matière de croissance économique et de coopération énergétique régionale, elle soulève également de graves préoccupations en matière de droits humains : déplacements forcés de populations, conditions de travail dangereuses et participation limitée des communautés. Les BHR ont pris une dimension mondiale avec l’adoption en 2011 des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (UNGPs pour l’acronyme en anglais). Comme l’a souligné le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), les États sont tenus, en vertu du droit international, de protéger les individus contre les abus commis par des tiers, y compris les entreprises, sur leur territoire. Dans le même temps, ces dernières ont la responsabilité de respecter les droits humains, en évitant de causer des préjudices et en remédiant aux impacts négatifs de leurs activités. Les victimes doivent également avoir accès à des recours efficaces, qu’ils soient judiciaires ou non judiciaires2.
Le cadre juridique national du Népal prévoit des protections sociales et du travail essentielles à travers la Constitution de 2015, la Loi sur le travail de 2017, la Loi sur la sécurité sociale de 2018, ainsi que le lancement récent de son premier Plan d’action national (PAN) sur les entreprises et les droits humains (2024–2028). Si ces mesures rapprochent le pays des standards internationaux, leur application demeure faible. Les entreprises considèrent souvent les obligations BHR comme de simples charges administratives plutôt que comme des garanties indispensables. Les lacunes de mise en œuvre s’expliquent par l’absence de mécanismes de suivi solides, un déficit de responsabilité et une faible sensibilisation, tant du côté des entreprises que des travailleurs et travailleuses.
Les outils internationalement reconnus, tels que les Évaluations d’impact sur les droits humains (HRIA) et les Évaluations d’impact à l’échelle sectorielle (SWIA), largement utilisés ailleurs, restent absents au Népal. Pourtant, ils permettraient d’évaluer les risques, de renforcer la responsabilité des entreprises et de protéger les groupes vulnérables. Conçus pour identifier, analyser et prévenir les impacts négatifs des activités économiques, ces outils peuvent être adaptés aux risques propres à chaque secteur, tout en gardant pour objectif central le renforcement de la protection et de la redevabilité. Pour progresser, le Népal devra adopter de tels outils, renforcer la sensibilisation des travailleurs et travailleuses et mettre en place des systèmes de rapport transparents afin de garantir une mise en œuvre effective de ses lois, notamment dans les secteurs à haut risque comme l’hydroélectricité. Cette approche s’inscrit dans le troisième pilier des UNGPs, qui définit le respect des droits humains par les entreprises comme une norme universelle de conduite. Dans le monde, au moins trente-et-un pays ont intégré les HRIA dans leurs dispositifs de responsabilité des entreprises, mais le Népal ne l’a pas encore fait3.
Dans le cadre de ce rapport, j’ai eu l’opportunité d’interviewer M. Bishnu Prasad Timilsina, avocat principal au Forum for Protection of Consumer Rights au Népal4, afin de discuter de l’état actuel des BHR dans le pays et des lacunes et défis que devront relever les décideurs politiques et les entreprises dans les années à venir. Au Népal, les BHR constituent un sujet encore récent, sans stratégie claire ni coordonnée de gouvernance, malgré leur reconnaissance mondiale depuis l’adoption des UNGPs en 2011. Une avancée majeure a été l’adoption, en mars 2024, du Plan d’action national sur les BHR, qui a enfin attiré l’attention nationale sur la question5. Cependant, en l’absence d’un cadre robuste et avec des investisseurs appliquant des approches divergentes, les entreprises échappent souvent à leurs principales obligations6. Beaucoup de dirigeants et de chefs d’entreprise perçoivent encore les exigences BHR comme des coûts supplémentaires pouvant réduire les profits en allongeant les cycles de projet. Ce vide réglementaire leur permet de contourner leurs obligations en matière de droits humains, fragilisant la responsabilité et la protection des travailleurs et des travailleuses. Il est donc crucial d’analyser comment les BHR sont pris en compte dans les projets financés par des régimes non occidentaux, dont les normes, priorités et mécanismes d’application diffèrent souvent de ceux des bailleurs occidentaux, et qui façonnent des standards distincts de conduite des entreprises dans le secteur hydroélectrique népalais.
Le secteur illustre une nette divergence entre les approches occidentales et non occidentales en matière de BHR. Les bailleurs occidentaux comme la Banque mondiale, l’IFC et la BAD appliquent généralement les cadres internationaux (UNGPs, normes IFC, lignes directrices de l’OCDE), qui exigent des garanties structurées, des rapports transparents et une participation communautaire. Par exemple, le projet Upper Trishuli-1 prévoit des fonds spécifiques pour les populations autochtones, mais n’a intégré les exigences de consentement libre, préalable et éclairé (CLPE/FPIC) qu’après l’implication de l’IFC7. En revanche, les projets soutenus par la Chine et l’Inde, tels que Arun III et Tamakoshi V, privilégient la rapidité et la conformité aux seules réglementations nationales, mais manquent souvent de transparence, de mécanismes de recours efficaces et de consultations adéquates, entraînant de fréquentes plaintes en matière de droits humains8. La comparaison montre que les projets financés par l’Occident sont plus lents mais mieux alignés sur les standards de droits humains, tandis que les projets financés par des acteurs non occidentaux sont plus rapides mais plus faibles en matière de garanties. Le Népal doit donc adopter une double stratégie : renforcer les normes de CLPE et de sécurité dans les projets financés par l’Occident, tout en améliorant la transparence, la responsabilité et la protection des communautés dans les projets financés par d’autres partenaires, afin de garantir un développement hydroélectrique inclusif et respectueux des droits.
L’examen du secteur hydroélectrique met en évidence des lacunes persistantes en matière de droits des travailleurs et des travailleuses, de consultations communautaires, de garanties environnementales et de responsabilité des entreprises. Les combler nécessitera une action coordonnée du gouvernement, des entreprises et de la société civile. Bien que le Népal dispose d’un cadre juridique solide, son application reste insuffisante : les travailleurs et travailleuses de l’hydroélectricité sont souvent confrontés à des conditions dangereuses, à une rémunération injuste et à un accès limité aux mécanismes de recours. Renforcer la protection de ces personnes contractuelꞏleꞏs et informelꞏleꞏs, comme l’a illustré le cas de Tamakoshi V, est essentiel. De même, l’imposition de conditions plus strictes par les bailleurs et une plus grande attention portée aux impacts sociaux et environnementaux sont indispensables. Les recommandations du Nepal BHR Network — incluant des évaluations sectorielles, des consultations inclusives, une attention particulière aux projets financés par les investissements directs étrangers (IDE) et la diligence raisonnable obligatoire en matière de droits humains (HRDD) — offrent une feuille de route pour la réforme. L’extension des HRIA, combinée à des formations et des incitations pour les entreprises, permettrait d’institutionnaliser davantage la responsabilité et de promouvoir un développement hydroélectrique plus respectueux des droits humains.
En conclusion, le Népal a franchi des étapes importantes vers l’élaboration d’un cadre BHR, notamment avec l’adoption de son premier Plan d’action national. Toutefois, le secteur hydroélectrique continue de souffrir d’une application faible des lois, d’une protection insuffisante des travailleurs et des travailleuses, de consultations communautaires limitées et de mécanismes de recours inadéquats. Le contraste entre bailleurs occidentaux, généralement conformes aux standards internationaux, et bailleurs non occidentaux, qui privilégient la rapidité au détriment des garanties, complique les avancées. Pour que le développement hydroélectrique soit à la fois durable et respectueux des droits humains, le Népal doit renforcer la responsabilité, imposer la diligence raisonnable en matière de droits humains et favoriser une participation inclusive et multipartite, transformant ainsi son expansion énergétique verte en un modèle de développement socialement responsable.
Notes et références
1. Nepal Development Initiative. (2025). NEDI – Creating Sustainable Change with Social Entrepreneurship. (n.d.). Consulté le 11 août 2025 de : https://www.nedi.org.np/
2. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2025). OHCHR and business and human rights. Consulté le 24 mai 2025 de : https://www.ohchr.org/en/business-and-human-rights
3. National Baseline Tool on Business and Human Rights. (n.d.). About. Consulté le 25 juin 2025 de : https://bhrbaseline.humanrights.dk/about
4. Forum for Protection of Consumer Rights- Nepal. (2025). Consulté le 21 août 2025 : de https://consumerright.org.np/
5. National Action Plans on Business and Human Rights. (n.d.). Nepal. Consulté le 24 mai 2025, de : https://globalnaps.org/country/nepal/
6. Aryal, S. (2024). Evolution and future prospects of hydropower sector in Nepal: A review. Heliyon, 10, p.1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024071706
7. ADB Institute. (2019). Upper Trishuli-1 Hydropower Project (Nepal). https://www.adb.org/projects/49086-001/main
8. República. (8 août 2024). NHRC receives complaints on negative impacts of hydropower projects. https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/nhrc-receives-complaints-on-negative-impacts-of-hydropower-projects