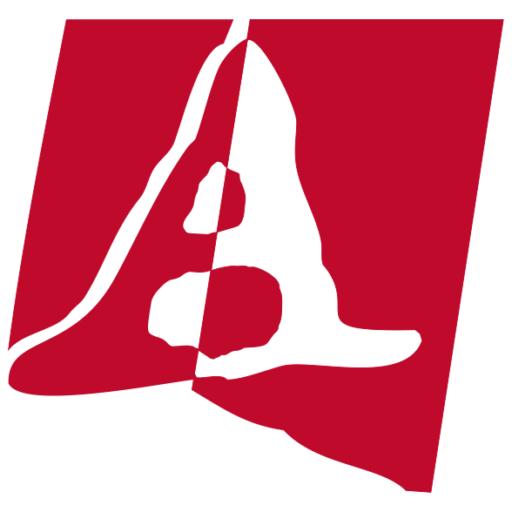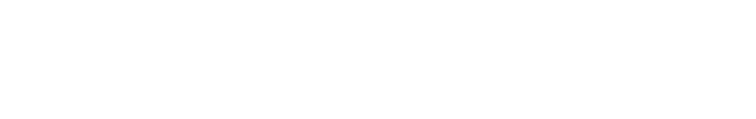Dans de nombreux conflits armés, le viol et plus généralement les violences sexuelles sont des armes de destruction psychologique et physique utilisées surtout contre des femmes afin de terroriser les populations. Or, malgré des résolutions des Nations unies et des condamnations internationales, les coupables sont rarement retrouvés et condamnés, comme récemment en RDC.
Le viol comme arme de guerre
Lorsque nous pensons aux armes de guerre, certains éléments tels que les fusils, les grenades et d’autres formes de munitions nous viennent souvent à l’esprit. Cependant, l’une des armes les plus répandues et les moins condamnées dans les zones de conflit est la violence sexuelle infligée aux femmes et aux jeunes filles, des plus jeunes aux plus âgées. Bien qu’il soit souvent éclipsé par des formes de violence plus conventionnelles, le viol est devenu un puissant outil de guerre, systématiquement utilisé pour briser des individus, des familles et des communautés entières. Cet article vise à mettre en lumière les conséquences dévastatrices de la violence sexuelle dans les conflits, en se concentrant sur les événements récents en République démocratique du Congo (RDC), et en explorant le bilan psychologique, physique et social des survivants1.
Une tragique récurrence à Muzenze
Une récente tragédie en RDC illustre de manière frappante cette dure réalité. Dans la région orientale du pays, alors que le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, progressait dans sa tentative de prendre le contrôle de Goma, une évasion massive a eu lieu à la prison locale. Le 27 janvier 2025, lorsque les rebelles ont réussi à prendre le contrôle de la ville, les prisonniers masculins ont exécuté leur plan d’évasion. Cependant, avant de s’enfuir, ils sont entrés dans l’aile réservée aux femmes de la prison et ont brutalement violé toutes les détenues. Après avoir mis le feu à la prison, les prisonniers ont pris la fuite. Sur les 165 femmes détenues dans l’établissement, toutes ont été violées et seules 9 à 13 ont survécu2. En raison du danger accru que représentent les groupes rebelles qui contrôlent la ville, l’enquête sur cette affaire a été insuffisante.
Muzenze n’en était pas à sa première tragédie. Un incident similaire s’était produit dans le même établissement dans la nuit du 21 au 22 juin 2009. À cette occasion, des détenus masculins avaient réussi à s’introduire dans l’aile réservée aux femmes à l’aide d’une grenade, blessant douze personnes et tuant une détenue et un policier. Ils ont ensuite détenu et agressé sexuellement une vingtaine de femmes. Finalement, les auteurs n’ont pas réussi à s’échapper, ce qui rend la brutalité de l’attaque encore plus insensée3.
Si l’on considère que les causes profondes de ces soulèvements – à savoir l’absence de politiques pénitentiaires, une alimentation inadéquate et des soins de santé insuffisants – ont déjà été bien documentées, il est profondément décourageant de constater que des incidents similaires se produisent encore 16 ans plus tard. La persistance de ces conditions ne reflète pas seulement une négligence systémique, mais signale également l’incapacité à mettre en œuvre des réformes significatives visant à prévenir de telles violences et à garantir les droits fondamentaux et la sécurité de toutes les personnes incarcérées4.
L’impact psychologique et physique de la violence sexuelle
On ne peut que s’interroger sur le fait que le premier réflexe de ces individus, confrontés à des circonstances dramatiques, soit de s’en prendre cruellement à des femmes qui n’ont rien fait pour provoquer leur souffrance. Se pourrait-il qu’infliger une telle violence soit le seul moment où ils ressentent un semblant de « pouvoir » ?
Dans le contexte de la guerre, le viol a longtemps été utilisé comme technique de guerre psychologique. Cet acte horrible terrorise et détruit des individus et des communautés entières. Les survivants sont souvent soumis à des horreurs indicibles, les victimes allant du bébé à la grand-mère. L’impact est considérable : les survivants subissent des traumatismes émotionnels, des dommages psychologiques, des blessures physiques, des grossesses non désirées, la stigmatisation sociale et des infections sexuellement transmissibles. Les communautés en souffrent énormément et il est scandaleux qu’au moins 1,8 million de cas de viols aient été signalés pendant le conflit en RDC depuis 1996.
Médecins sans frontières a traité plus de 25 000 survivant·es pour la seule année 2024, soit plus de deux par heure5. Les Nations unies ont fait état d’une augmentation de 270 % des violences sexuelles entre janvier et février 2025, directement liée au conflit à Goma et à l’affaire de la prison de Muzenze6. Dans certains camps de déplacés, 80% des femmes ont déclaré avoir été violées7. Des groupes armés ont violé des mineurs âgés de 10 ans8.
Le viol, dans ces cas, transcende l’acte physique lui-même. Il devient un rituel de déshumanisation. Certaines femmes sont violées devant leurs proches, morts ou vivants. D’autres sont coupées, brûlées, mutilées, puis violées. Certaines sont même agressées par leur propre fils, ou soumises à un viol collectif, un homme après l’autre, devant leur famille. Ces actes visent non seulement à infliger une douleur inimaginable à l’individu, mais aussi à démanteler des familles et des communautés entières9. Nombreux sont ceux qui pensent qu’il s’agit d’une tactique délibérée pour forcer les populations locales à fuir à l’arrivée des auteurs, facilitant ainsi leurs efforts pour annexer les zones qu’ils ciblent.
Déshumanisation et destruction des communautés
Bien que le viol dans les conflits soit désormais reconnu comme un crime contre l’humanité et un crime de guerre lorsqu’il est généralisé et systématique, il est frustrant de constater qu’il reste largement impuni10. En vertu du droit international, et notamment du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998), le viol est explicitement considéré comme un crime contre l’humanité (article 7) et un crime de guerre (article 8). Ce cadre juridique oblige les États à enquêter sur ces crimes et à les poursuivre, mais l’application de la loi reste minimale. Le viol en tant qu’arme de guerre est souvent oublié dans les négociations de paix, n’est pas suffisamment signalé et ne fait pas l’objet d’enquêtes suffisantes. Cette incapacité à tenir les auteurs responsables laisse les survivants isolés, rejetés par leur propre famille et leur communauté dans de nombreux cas, les exposant ainsi à de nouveaux traumatismes et à l’insécurité11.
| Statistiques | Détails | Source | Année |
|---|---|---|---|
| Augmentation de 270% des violences sexuelles | Les Nations unies ont signalé une augmentation de 270 % des cas de violence sexuelle entre janvier et février 2025, y compris des viols massifs dans la prison de Munzenze. | The Times | 2025 |
| Plus de 25 000 survivant.es traités | Médecins sans frontières a aidé plus de 25 000 survivant.es de violences sexuelles en 2024 (plus de deux par heure). | Parlement européen | 2024 |
| 80% des femmes déplacées sont violées | Dans certains camps, 80 % des femmes déplacées ont déclaré avoir été violées. | Parlement européen | 2024 |
| Enfants en tant que victimes | Les groupes armés ont violé des mineurs, dont certains n'avaient que 10 ans. | Reuters | 2025 |
Tableau : données sur les violences sexuelles et viols en RDC
Le silence mondial et l’impunité autour du viol dans les conflits
A la lumière des horreurs décrites, il devient douloureusement évident que la violence sexuelle dans les zones de conflit, en particulier le viol, n’est pas simplement une conséquence accidentelle de la guerre, mais une arme calculée de destruction psychologique et physique. Les récits de Muzenze et le contexte plus large de la RDC dressent un portrait tragique de la façon dont les femmes et les filles sont systématiquement prises pour cible, leurs souffrances étant exacerbées par l’absence de responsabilité et de soutien aux survivants. Bien qu’il soit reconnu comme un crime de guerre, le recours au viol comme tactique se poursuit sans contrôle, laissant de profondes cicatrices non seulement sur les individus, mais aussi sur des communautés entières. Le silence qui entoure cette question, tant dans le discours international que dans les contextes locaux, perpétue le cycle de la violence et de l’impunité.
Il est essentiel que la communauté mondiale reconnaisse et traite cette forme brutale de guerre avec l’urgence et le sérieux qu’elle exige. Les survivants ne doivent pas être laissés seuls face à leur douleur, mais doivent bénéficier de la justice, des soins et de la protection. Ce n’est qu’alors que nous pourrons commencer à espérer un avenir où les femmes et les filles des zones de conflit ne seront pas considérées comme un butin de guerre, mais comme des individus méritant la dignité, la sécurité et la paix.
Notes et références
1. Conseil de sécurité des Nations unies. (2008). Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits.
2. Lamb., C. (avril 2025). « Dr Miracle tells the West: Stop ignoring our war ». The Times. Récupéré de : https://www.thetimes.co.uk/article/democratic-republic-congo-rwanda-conflict-dr-denis-mukwege-cdz56n03d
3. Human Rights Watch. (2002). The War Within the War: Sexual Violence Against Women and Girls in the Democratic Republic of Congo. Récupéré de https://www.hrw.org/reports/2002/drc/Congo0602.pdf. ISBN : 1-56432-276-9
4. Amnesty International. (2011). « Democratic Republic of the Congo: Rape as a weapon of war ».
5. European Parliament (2024). « Debate on the use of sexual violence as a weapon of war in the Democratic Republic of the Congo ». Récupéré de : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-10-2024-12-17-INT-2017008904395_EN.html
6. Lamb., C. (avril 2025). « Dr Miracle tells the West: Stop ignoring our war ». The Times. Récupéré de : https://www.thetimes.co.uk/article/democratic-republic-congo-rwanda-conflict-dr-denis-mukwege-cdz56n03d
7. European Parliament (2024). « Debate on the use of sexual violence as a weapon of war in the Democratic Republic of the Congo ». Récupéré de : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-10-2024-12-17-INT-2017008904395_EN.html
8. Reuters (2025). « Children face lethal violence, rape in east Congo war ». Récupéré de : https://www.reuters.com/world/africa/children-face-lethal-violence-rape-east-congo-war-2025-02-24/
9. Human Rights Watch. (2002). The War Within the War: Sexual Violence Against Women and Girls in the Democratic Republic of Congo. Récupéré de https://www.hrw.org/reports/2002/drc/Congo0602.pdf. ISBN : 1-56432-276-9
10. Conseil de sécurité des Nations unies. (2008). Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits.
11. Amnesty International. (2011). « Democratic Republic of the Congo: Rape as a weapon of war ».