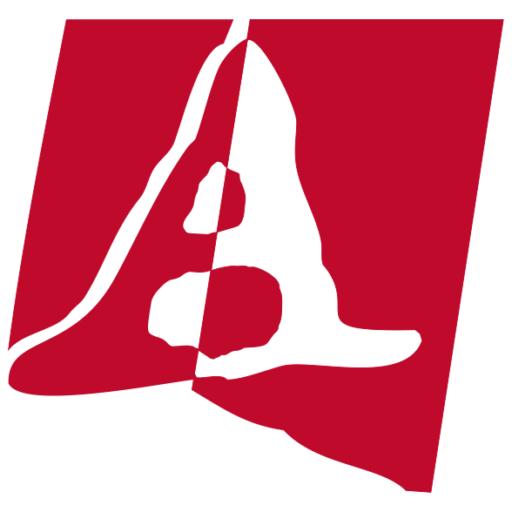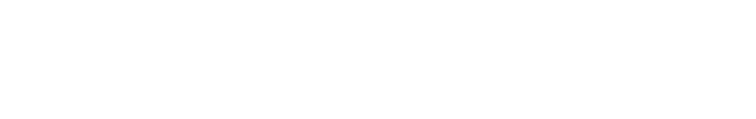Après son indépendance en 1956, la Tunisie a adopté un modèle de développement basé sur l’extractivisme, comme de nombreux pays du Sud global, lui permettant de se projeter sur la scène internationale1. Encore aujourd’hui, l’économie tunisienne repose principalement sur l’exportation de ses ressources naturelles et sur la vente de sa main-d’œuvre à bas coût. Ces choix économiques impactent négativement les conditions de travail ainsi que l’état de l’environnement en Tunisie.
Qu’est-ce que l’extractivisme?
L’extractivisme se définit comme étant :
[…] un mode d’accumulation qui a commencé à se développer massivement il y a 500 ans. L’économie mondiale – le système capitaliste – a commencé à se structurer avec la conquête et la colonisation des Amériques, de l’Afrique et de l’Asie. Ce mode d’accumulation extractiviste a été déterminé depuis lors par les exigences des centres métropolitains du capitalisme naissant. Certaines régions se sont spécialisées dans l’extraction et la production de matières premières – les produits de base – tandis que d’autres se sont consacrées à la production de biens manufacturés. Les premières exportent la nature, les secondes l’importent2. [Traduction libre]
L’ensemble s’inscrit dans un modèle de domination structurel, qualifié de néocolonialisme, dans lequel les dynamiques de dépendance et l’héritage colonial règnent. Le processus « d’accumulation par dépossession »3 permet aux pays du Nord global de non seulement tirer profit des ressources naturelles des pays du Sud, mais aussi de leur force de travail, exploité à bas coûts et dans des conditions inhumaines4. Les pays du Sud global, n’ayant pas bénéficié de la même croissance que celle des pays du Nord, ont donc eu recours à l’extractivisme afin de compétitionner sur le marché international5.
L’extractivisme est un modèle de développement non durable, responsable de la pollution de l’environnement et du déclin de la santé publique. Les pays riches en ressources naturelles font face aux plus gros défis de développement en termes d’inégalités sociales et de défis climatiques. Malgré l’abondance de leurs ressources, ces derniers connaissent un développement lent souvent expliqué par la « malédiction des ressources » ou le « paradoxe de l’abondance »6. Selon certains chercheurs, les pays du Sud global seraient condamnés au sous-développement en raison de la concentration de leurs ressources naturelles, principalement destinées à l’exportation dans le cadre de logiques extractivistes7.
Étude de cas : l’industrie du textile en Tunisie
Le secteur du textile est une figure emblématique des problèmes socio-économiques et environnementaux causés par l’extractivisme. Le peuple tunisien subit actuellement les répercussions humaines et écologiques perpétuées par sa dépendance envers le Nord global, donneur d’ordres et hôtes des plus grandes entreprises de vêtements8. En effet, les entreprises en amont dans la chaîne de valeur monopolisent le pouvoir et l’autorité sur les conditions de production auxquels sont assujettis les pays sous-traitant comme la Tunisie9. Le coût-minute, les délais injustes, les contrats infléchis résultent tous de la réduction au maximum des conditions de travail pour favoriser le profit des grandes marques10. Les attentes des pays sous-traitants sont calculées à partir des standards technologiques et professionnels qu’on retrouve dans le Nord global, qui a accès à plus de ressources. Les femmes, qui forment majoritairement la main-d’œuvre de ce secteur, sont sous-payées, licenciées abusivement et engagées sous des contrats à durée déterminée, les privant donc d’une couverture sociale11. Les usines de ces grandes entreprises sont caractérisées par des conditions de travail indécentes comme un nombre insuffisant de toilettes, le refus de pause, la fermeture sans préavis et des salaires très bas12. Ces conditions ne permettent pas aux ouvriers et ouvrières d’accumuler du profit.
Sur le plan environnemental, l’eau, « moteur de la vie », est rapidement devenue indispensable pour l’industrie du textile tunisien13. Le secteur du textile est reconnu pour le rejet des eaux usées, contaminées par des produits chimiques tels que les teintures, l’eau de Javel, l’eau oxygénée et le métabisulfite de sodium, tous utilisés dans la production du textile14. Ces eaux sont ensuite rejetées dans les bassins sans traitement, ou sans avoir été réellement purifiées. La proximité historique de la culture tunisienne à la mer Méditerranée est aujourd’hui menacée par la pollution. La population est contrainte de vivre à proximité de sources d’eau polluées par les rejets de l’industrie du textile, ce qui accentue le taux de cancers, interdit la baignade et contraint les petits pêcheurs à se disperser, en raison de la diminution des réserves de poissons1516. Le cas de la baie de Monastir est symbolique de cet enjeu.
Alors, comment s’en sortir?
Alors que certains chercheurs croient que l’extractivisme est une fatalité pour les pays du Sud global, la population tunisienne refuse d’adopter cette vision déterministe17.
Compte tenu des limitations du pays, alors que l’État privilégie l’endettement au lieu de mener des réformes structurelles, et que les instances internationales perpétuent ce modèle économique axé sur le remboursement de la dette au détriment d’un développement respectueux de l’environnement et des droits humains, les Tunisiens cherchent constamment des alternatives pour rompre cette dépendance à l’extractivisme18.
Mon stage en Tunisie fut marqué par l’ambition des Tunisiens à trouver des solutions pour remédier aux conséquences de l’extractivisme. Plusieurs organismes et entreprises durables sont nées de l’innovation tunisienne et la volonté du peuple de reprendre son pouvoir. Ces initiatives visent à repenser l’économie du pays et à l’inscrire dans une dynamique d’économie sociale et solidaire.
Quelques projets à l’image de l’innovation tunisienne
Les mains solidaires
Afin de remédier à l’exploitation de la main-d’œuvre et aux conditions de travail précaires dans l’industrie du textile, un groupe de femmes de la région de Ksibet el Medouini a formé une coopérative avec le soutien du Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES)19. Cette coopérative est gérée par ses adhérentes, qui suivent des formations en gestion d’entreprise mises en place par le FTDES, afin d’acquérir les compétences nécessaires au bon fonctionnement et à la durabilité de la coopérative.
Cette initiative a pour objectif la réintégration, de manière formelle, des femmes injustement licenciées sur le marché du travail. Elle permet aux adhérentes de s’échapper de l’exploitation du marché du travail et d’améliorer leur situation économique en offrant un salaire juste contrairement aux usines de grandes entreprises qui offrent de 15 à 20 dinars par jour, équivalent à 7 à 10 dollars canadiens. La coopérative compte aujourd’hui un total de 48 membres et elle s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire consolidant les besoins économiques ainsi que sociaux de ces femmes.
Le projet Nasij

Dans la même optique, le projet Nasij (Nouvelles Alternatives Soutenables pour l’Insertion des Jeunes dans le Secteur Textile) vise à renforcer l’expertise en textile durable, en impliquant des acteurs à chaque étape de la chaîne de valeur, afin de promouvoir le développement d’une industrie du textile plus respectueuse des conditions de travail et de l’environnement20.
Le projet est financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICD) et fait appel à plusieurs acteurs tunisiens et italiens tels que la Coopération pour le Développement des Pays Émergents (COSPE), le Comité Européen pour la Formation et l’Agriculture (CEFA), l’Institut Supérieur de la Mode de Monastir, le centre de formation à Ksar Hellal, l’usine Sartex, l’entreprise SOTRAFIB ainsi que le FTDES21.
L’implication de ce grand nombre d’acteurs illustre la complexité de l’enjeu et souligne la nécessité d’une collaboration pour repenser l’industrie du textile marquée par les pratiques d’extractivisme et de productivisme. Toujours en phase diagnostic, le projet a pour objectif d’améliorer la formation des employées, la rétention de l’entreprise ainsi que la durabilité du processus de production du textile22. Il est question d’offrir des emplois décents et sortir de la production abusive qui nuit à l’environnement.
L’usine SOTRAFIB

La société de transformation de fibres, SOTRAFIB, est spécialisée dans le recyclage du textile en Tunisie23. Durant notre visite de l’usine, nous avons pu découvrir les multiples bénéfices d’une usine de ce type. En premier lieu, l’employabilité est un enjeu au cœur des préoccupations des jeunes tunisiens. Dans un pays comme la Tunisie, où l’exode des cerveaux s’accroit et le taux de chômage est flagrant, la création d’emploi est importante24. En plus, de générer des emplois dans l’usine Sotrafib située dans la région de Monastir, à Ksibet El Médiouni, l’entreprise offre des emplois indirects aux individus leur permettant de collecter les résidus de textiles en échange d’une petite somme d’argent25.
En Tunisie, la méthode de gestion des déchets la plus répandue et privilégiée consiste à enfouir les résidus dans des sites d’enfouissement, qui finissent souvent par contaminer l’environnement26. Une autre méthode d’élimination des déchets est l’incinération, ce qui est une importante source de rejets de contaminants dans l’atmosphère27 comme des particules fines ou des toxines reconnues cancérigènes. De plus, l’incinération est une source d’émission de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Pour contrer cette pollution, l’usine Sotrafib permet le recyclage des retailles de tissus et réduit la quantité de déchets28.

Les produits manufacturés sont multiples : des articles non tissés consacrés à l’usage industriel, l’isolation, des protège-sols pour l’agro-textile, des bassins de réservoir d’eau isolés par des tapis de textiles recyclés, etc29. L’entreprise importe d’anciennes machines européennes afin de les remettre en état de marche, un autre moyen de réutiliser des matériaux au lieu de les envoyer dans les zones de décharge30. Cette usine permet de créer une valeur ajoutée à plus de 1500 tonnes de déchets textiles chaque année31.
En somme, bien que l’extractivisme ait profondément marqué le développement de la Tunisie, des initiatives locales donnent espoir à un avenir durable et responsable, tant pour les conditions de travail que pour l’environnement. Les entreprises innovantes contribuent au développement socio-économique du pays; il est donc essentiel de continuer à les soutenir.
Notes et références
1. Université de Sherbrooke. (s.d). Proclamation de l’indépendance de la Tunisie. Perspective Monde. Récupéré de : https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve/340
2. Acosta, A. (2013). Extractivism and Neoextractivism: Two sides of the same curse. Dans Lang, M. & Mokrani, D (Eds.), Beyond Development: Alternative Visions from Latin America. (pp. 61-86). Rosa Luxemburg Foundation. Récupéré de : https://www.tni.org/files/download/beyonddevelopment_extractivism.pdf
3. Harvey, D. (2017), « The “New” Imperialism: Accumulation by Dispossession ». Dans K.B. Anderson et B. Ollman, Karl Marx (pp. 213-237). Londres : Routledge.
4. Langlois, M-D, Magaña Canul, R-I. (2023). Extractivisme(s). Anthropen. Récupéré de : https://doi.org/10.47854/anthropen.v1i1.51731
5. Beaudet, P., & Haslam, P. (Eds.). (2019). Enjeux et défis du développement international : Acteurs et champs d’action. University of Ottawa Press/Les Presses de l’Université d’Ottawa.
6. Acosta, A. (2013). Extractivism and Neoextractivism: Two sides of the same curse. op. cit.
7. Acosta, A. (2013). Extractivism and Neoextractivism: Two sides of the same curse. op. cit.
8. Hassine, M. (Communication personnelle, avril 2025).
9. ibid.
10. ibid.
11. Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. (19 juin 2014). Consécration des DESC pour 311 ouvriers et ouvrières du textile. Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. https://ftdes.net/consecration-des-droits-economiques-et-sociaux-pour-311-ouvriers-et-ouvrieres-du-textile__trashed/
12. ibid.
13. Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. ( 15 août 2023). L’eau, quand le moteur de la vie devient le moteur des conflits. Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux. https://ftdes.net/leau-quand-le-moteur-de-la-vie-devient-le-moteur-des-conflits/
14. Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. (18 avril 2019). Le secteur textile au Sahel : Une politique industrielle non durable. Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux. https://ftdes.net/le-secteur-textile-au-sahel-une-politique-industrielle-non-durable/
15. Robert, D. (2015). Une expérience d’expertise citoyenne en Tunisie – l’étude de la pollution de la baie de Monastir. AITEC (Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs) et FTDES (ForumTunisien pour les Droits Economiques et Sociaux). https://aitec.reseau-ipam.org/IMG/pdf/note_expertise_citoyenne_tunisie_baie_de_monastir.pdf
16. Akari, N. (28 septembre 2013). Pollution : Baie de Monastir à Ksibet El Mediouni, un « triangle de la mort ». Nawaat. https://nawaat.org/2013/09/28/pollution-baie-de-monastir-a-ksibet-el-mediouni-un-triangle-de-la-mort/
17. Acosta, A. (2013). Extractivism and Neoextractivism: Two sides of the same curse. op. cit.
18. Hassine, M. (Communication personnelle, avril 2025).
19. Les Mains Solidaires. (n.d.). Les Mains Solidaires [Page Facebook]. Facebook. https://www.facebook.com/LesMainSolidaires
20. Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. (2025). Formulaire NASIJ. [Données internes non publiées].
21. ibid.
22. ibid.
23. Sotrafib. (n.d.). Accueil. Sotrafib. http://sotrafib.com/Fr/accueil
24. Institut Tunisien des Études Stratégiques. (2024). NASIJ – Nouvelles Alternatives Soutenables pour l’Insertion des Jeunes dans le secteur textile. https://www.admin.ites.tn/api/uploads/6682a454a5b34162629a93c6_0.pdf
25. Hassine, H. (Communication personnelle, avril 2025).
26. Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement. (2014). Rapport sur la gestion des déchets solides en Tunisie. SWEEP-Net. http://www.collectiviteslocales.gov.tn/wp-content/uploads/2019/04/rapportsweepnet.pdf
27. ibid.
28. Sotrafib. (n.d.). Accueil. Sotrafib. http://sotrafib.com/Fr/accueil
29. ibid.
30. Institut Tunisien des Études Stratégiques. (2024). op. cit.
31. Sotrafib. (n.d.). Accueil. Sotrafib. http://sotrafib.com/Fr/accueil